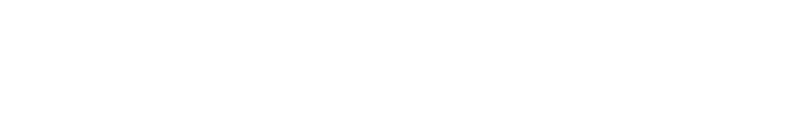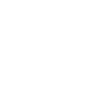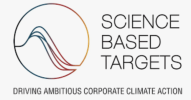Un sol bien nourri, c’est un sol fertile, vivant et productif. Dans l’agriculture régénératrice, la maximisation de la biomasse joue un rôle central : elle permet de restaurer la fertilité des terres, de stimuler l’activité biologique des sols et de capter durablement du carbone. Une stratégie gagnante, à la fois pour l’agriculteur, pour le climat et pour la planète.
Qu’est-ce que la biomasse, et pourquoi est-elle si essentielle au sol ?
La biomasse désigne l’ensemble de la matière organique issue des plantes : feuilles, tiges, racines, couverts végétaux, résidus de culture… Ce sont ces éléments qui, une fois déposés ou incorporés dans le sol, nourrissent les micro-organismes et contribuent à la création d’humus.
Dans un sol vivant, la matière organique joue un rôle fondamental :
- Elle améliore la structure du sol et sa porosité,
- Elle favorise la rétention d’eau et limite le ruissellement,
- Elle constitue une réserve de nutriments disponibles pour les plantes,
- Elle stimule l’activité biologique, notamment celle des champignons mycorhiziens et des bactéries fixatrices d’azote.
C’est aussi dans cette matière organique que se stocke le carbone capté dans l’atmosphère par les plantes via la photosynthèse. Autrement dit, plus de biomasse = plus de carbone séquestré dans le sol.
Un levier agronomique et climatique
Maximiser la biomasse permet d’enclencher un cercle vertueux sur l’ensemble de l’exploitation:
- Amélioration de la fertilité : des sols riches en matière organique sont plus productifs, plus faciles à travailler, et nécessitent moins d’engrais chimiques.
- Résilience face au climat : un sol qui retient mieux l’eau résiste mieux aux sécheresses comme aux excès de pluie.
- Réduction des intrants : grâce à une meilleure nutrition naturelle, les besoins en engrais azotés et en produits phytosanitaires diminuent.
- Stockage de carbone : un hectare de sol bien géré peut stocker entre 0,2 et 1 tonne de CO₂ par an, uniquement grâce à la biomasse produite sur place.
Produire sa biomasse à la ferme : une autonomie précieuse
L’un des grands principes de l’agriculture régénératrice est l’autonomie en matière organique. L’objectif est de produire localement la biomasse nécessaire, sans dépendre d’intrants extérieurs.
Plusieurs pratiques permettent de maximiser la biomasse sur une exploitation :
- Implantation de couverts végétaux diversifiés entre deux cultures principales pour nourrir le sol toute l’année,
- Utilisation et valorisation des résidus de culture (paille, tiges de maïs, fanes…),
- Introduction ou maintien de prairies permanentes ou temporaires,
- Compostage à la ferme, à partir de fumier, de déchets verts ou de résidus agricoles,
- Pâturage tournant pour optimiser la repousse des végétaux et les exsudats racinaires.
Ces pratiques favorisent non seulement la régénération des sols, mais permettent aussi de réduire les coûts liés aux apports d’engrais ou à l’achat de composts extérieurs.
Des résultats visibles sur le terrain
De nombreux agriculteurs accompagnés par ReGeneration ont déjà constaté les bénéfices concrets de cette approche :
- Des sols plus souples et faciles à travailler,
- Une augmentation de la biodiversité (vers de terre, faune microbienne),
- Une meilleure portance même en période humide,
- Des cultures plus homogènes et moins sensibles aux stress climatiques.
Ces bénéfices sont d’autant plus intéressants qu’ils s’inscrivent dans une logique économique : à mesure que la biomasse produite sur la ferme remplace les intrants extérieurs, les charges baissent, et la rentabilité des parcelles augmente.
Un rôle clé dans la transition agroécologique
Maximiser la biomasse, ce n’est pas simplement “faire pousser plus” : c’est changer de regard sur ce que l’on produit. Ce qui pousse sur la ferme n’est plus seulement destiné à être récolté, mais aussi à nourrir le sol, à stocker du carbone et à renforcer la résilience de l’exploitation.
Dans cette logique, la biomasse devient un pilier stratégique de la transition agroécologique. Elle permet de restaurer les écosystèmes agricoles, de répondre aux enjeux climatiques, et de construire des systèmes de production plus durables et plus souverains.