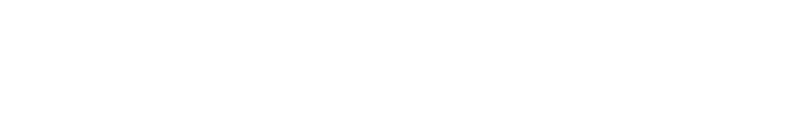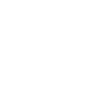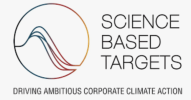Le dérèglement climatique compromet la capacité des agriculteurs à produire. D’ici 2100, les rendements agricoles pourraient chuter de 11 % à 24 % dans le monde. Cette réalité est d’autant plus inquiétante qu’elle concerne toutes les grandes cultures, partout sur la planète, malgré les efforts d’adaptation.
Un impact global sur la sécurité alimentaire
Pour comprendre l’ampleur du phénomène, regardons les chiffres. En juin 2025, une étude publiée dans Nature a analysé 12.658 régions agricoles dans 54 pays sur six cultures clés (maïs, blé, soja, manioc, sorgho, riz). Leur conclusion est sans appel : chaque degré supplémentaire de réchauffement réduira la capacité de la planète à produire d’environ 4,4 % de la consommation quotidienne.
Concrètement, les modélisations montrent que d’ici la fin du siècle et dans un scénario d’émissions modérées, les rendements agricoles pourraient baisser de 22 % pour le soja, 13,5 % pour le blé et 12 % pour le maïs. Des pertes d’autant plus inquiétantes que le Climate Impact Lab de Stanford a corroboré ces projections : dans le meilleur des cas (scénario bas-carbone), la baisse mondiale sera d’environ 11 % d’ici 2100, et dans le pire des cas (émissions élevées), jusqu’à 24 % de pertes. À plus court terme, d’ici 2050, une baisse d’environ 8 % est déjà attendue dans tous les scénarios.
Des adaptations agricoles qui montrent déjà leurs limites
Face à ces menaces, les agriculteurs du monde entier ne restent pas les bras croisés. Nouvelles variétés tolérantes à la chaleur, ajustement des dates de semis, irrigation contrôlée : les leviers d’adaptation sont déjà actionnés (Guardian, juin 2025). Cependant, ces ajustements restent largement en-deçà de l’ampleur du problème. D’après l’étude de Nature, ces mesures ne pourraient limiter les pertes que de 23 % d’ici 2050 et 34 % d’ici 2100. Autrement dit, même en tenant compte des adaptations actuelles, les rendements agricoles baisseront.
Le Guardian le résume bien : « les mesures d’adaptation actuelles n’amortissent qu’à la marge les pertes futures ». Certaines cultures comme le riz pourraient temporairement profiter d’un climat plus chaud – jusqu’à +4,9 % de rendements grâce aux nuits plus douces – mais ce gain reste une exception dans un tableau globalement pessimiste. La plupart des cultures clefs voient au contraire leur probabilité de déclin osciller entre 70 % et 90 % d’ici la fin du siècle (Nature).
Enfin, les « greniers à blé » actuels, pourtant les plus productifs, pourraient perdre jusqu’à 41 % de leurs rendements d’ici 2100, tandis que les pays aux revenus les plus faibles verraient une baisse d’environ 28 %.

Des conséquences socio-économiques déjà en marche
Ces pertes de rendements agricoles ne sont pas qu’un sujet pour les agronomes : elles touchent directement les entreprises, les gouvernements et les consommateurs.
La baisse de la production alimentaire mondiale menace la stabilité économique. D’après le Climate Impact Lab, les pertes les plus fortes concerneront le Midwest américain – cœur de la production de maïs et de soja – et l’Europe de l’Est . « On commence à se demander si la Corn Belt sera la Corn Belt de demain », alerte Andrew Hultgren, économiste à l’Université de l’Illinois.
En parallèle, les pays les moins développés seront les moins armés pour amortir le choc. Les communautés d’agriculture de subsistance, qui dépendent directement de petites récoltes de manioc ou de sorgho, pourraient être les premières touchées. Et même les pays agricoles les plus prospères, comme le Canada ou la Russie, qui pourraient dans un premier temps voir leurs rendements augmenter grâce au climat plus chaud, risquent d’être affectés sur le long terme par la volatilité des marchés et la dépendance accrue aux importations.
C’est une onde de choc qui n’épargne aucun territoire : chute des rendements, tensions sur les marchés, insécurité alimentaire. Qu’on soit au Nord ou au Sud, l’agriculture est en première ligne.
Vers une transformation profonde : que faire ?
Face à l’ampleur du défi, il est clair qu’il faut aller au-delà d’une simple adaptation : il est urgent d’engager une transformation profonde des systèmes agricoles.
Voici trois leviers prioritaires :
Restaurer la santé des sols.
Des sols vivants et riches en matière organique absorbent mieux l’eau, résistent à l’érosion et soutiennent les rendements. Pour y parvenir : pratiquer le couvert végétal entre les cultures, diversifier les rotations, planter des haies et introduire l’agroforesterie. La recherche le prouve : des sols bien gérés amortissent les chocs climatiques
Gérer l’eau intelligemment.
Face aux sécheresses, une irrigation contrôlée, des sols plus perméables, la création de retenues collinaires et la recharge des nappes phréatiques deviennent essentielles. Dans de nombreuses régions agricoles, la priorité est de mieux stocker l’eau en amont pour la restituer aux cultures au moment propice.
Diversifier les productions agricoles.
La dépendance à quelques monocultures est une vulnérabilité en période de climat instable. Diversifier les semis, en intégrant de nouvelles espèces, en valorisant les filières locales, permet de réduire le risque d’effondrement d’un secteur face aux extrêmes climatiques.
En parallèle, il est indispensable d’accélérer l’innovation agricole : variétés tolérantes aux températures extrêmes, systèmes numériques d’alerte, biotechnologies… Comme le rappellent Hsiang et Hultgren dans leur étude (Nature), ces solutions nécessitent des investissements soutenus. Or, ces moyens font encore défaut dans de nombreuses régions agricoles du globe, notamment dans les pays à faibles revenus, alors que ce sont précisément ces communautés qui subissent le plus durement les aléas climatiques.
Enfin, les gouvernements, les entreprises agroalimentaires et les agriculteurs eux-mêmes doivent collaborer pour créer des chaînes d’approvisionnement résilientes.
Ces projections nous rappellent qu’il est urgent de transformer en profondeur notre manière de produire. Il ne suffit plus d’ajuster nos pratiques : il faut aller vers une agriculture qui protège les sols, gère l’eau durablement et diversifie les approvisionnements pour limiter les risques. Face aux impacts du climat sur l’agriculture, seule une action coordonnée – associant agriculteurs, entreprises, pouvoirs publics et consommateurs – permettra de garantir notre sécurité alimentaire à long terme.

Restaurer la santé des sols est primordiale
Nous sommes à la croisée des chemins. Les chiffres rappellent que les rendements agricoles seront durablement affectés d’ici 2050, et plus encore d’ici 2100. La baisse annoncée, jusqu’à 24 % dans un scénario à fortes émissions, n’est pas une fatalité si nous agissons dès maintenant.
Pour éviter que la production alimentaire mondiale ne décroche trop brutalement et créer les clefs d’un système agricole résilient, il faudra restaurer la santé des sols, gérer l’eau intelligemment, diversifier les cultures et approvisionnements agricoles, investir dans l’innovation et les pratiques régénératrices, et collaborer à l’échelle internationale.
À nous de saisir ce levier pour qu’à l’horizon 2100, l’agriculture mondiale reste capable de nourrir la planète.