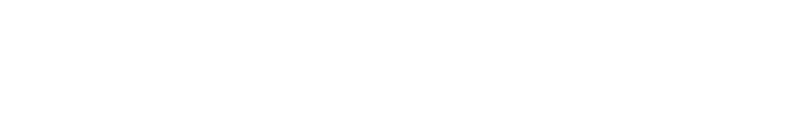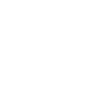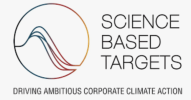Des prairies pour restaurer les sols et renforcer la production
Dans les systèmes agricoles régénératifs, le pâturage n’est pas une simple gestion des troupeaux. C’est un levier agronomique central, capable de restaurer la santé des sols, d’augmenter la productivité des prairies et de renforcer l’autonomie des fermes. En particulier, le pâturage tournant fait aujourd’hui ses preuves comme outil de régénération.
Le pâturage tournant : une méthode inspirée par la nature
Théorisé et popularisé par André Voisin dès les années 1950, le pâturage tournant consiste à diviser une parcelle en plusieurs sous-segments, dans lesquels les animaux ne séjournent que brièvement, avant que l’herbe ne soit laissée au repos pendant plusieurs semaines. Ce rythme alterné permet à la prairie de se régénérer, de produire davantage de biomasse, et de mieux structurer le sol.
Contrairement au pâturage continu, qui appauvrit les sols et épuise les espèces végétales dominantes, le pâturage tournant favorise la diversité, relance la photosynthèse après chaque passage, et stimule la vie microbienne du sol grâce aux apports de matières organiques animales.
Une prairie bien gérée est un puits de carbone et un moteur de fertilité
Le sol sous prairie permanente est l’un des écosystèmes les plus performants pour séquestrer du carbone : grâce à la densité racinaire, aux apports organiques continus, à l’absence de travail mécanique. Un système bien conduit permet non seulement de stocker du CO2 atmosphérique, mais aussi de retenir l’eau, de limiter l’érosion, de favoriser les vers de terre et d’améliorer la structure des horizons superficiels.
Les animaux deviennent alors des alliés du sol, non plus des perturbateurs.
Et contrairement aux idées reçues, cette gestion ne réduit pas la productivité, au contraire. Des essais montrent que les prairies conduites en pâturage tournant produisent souvent 30 à 50 % de biomasse en plus, tout en diminuant les besoins en aliments complémentaires. La production est plus autonome, moins dépendante des achats extérieurs, plus résiliente aux aléas.
Restaurer l’autonomie des fermes
Avec la montée des coûts (aliments, engrais, carburant), l’autonomie devient une condition de viabilité économique. Une prairie gérée avec soin devient une ressource centrale : elle fournit fourrage, fertilité, biodiversité… et un sol vivant pour les cultures à venir.
À l’inverse, un sol surexploité par le surpâturage devient compact, hydrophobe, pauvre en matière organique – et finit par nécessiter toujours plus d’intrants pour fonctionner.
Un levier stratégique pour l’agriculture de demain
La prépondérance des prairies dans les systèmes régénératifs n’est pas une nostalgie pastorale. C’est un choix agronomique, économique, climatique. C’est une réponse au besoin de restaurer des sols dégradés, de réduire les intrants, d’adapter les fermes aux sécheresses.
Mettre le pâturage au centre n’est pas un retour en arrière. C’est une décision agronomique et stratégique. Cela répond à trois urgences majeures : régénérer les sols agricoles, aujourd’hui épuisés par l’intensification ; réduire les intrants et construire des fermes plus autonomes ; adapter les systèmes d’élevage aux aléas climatiques croissants.