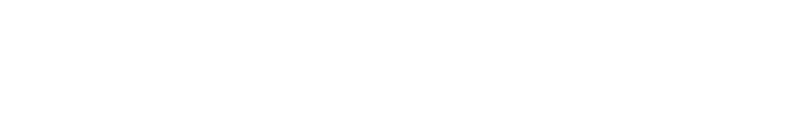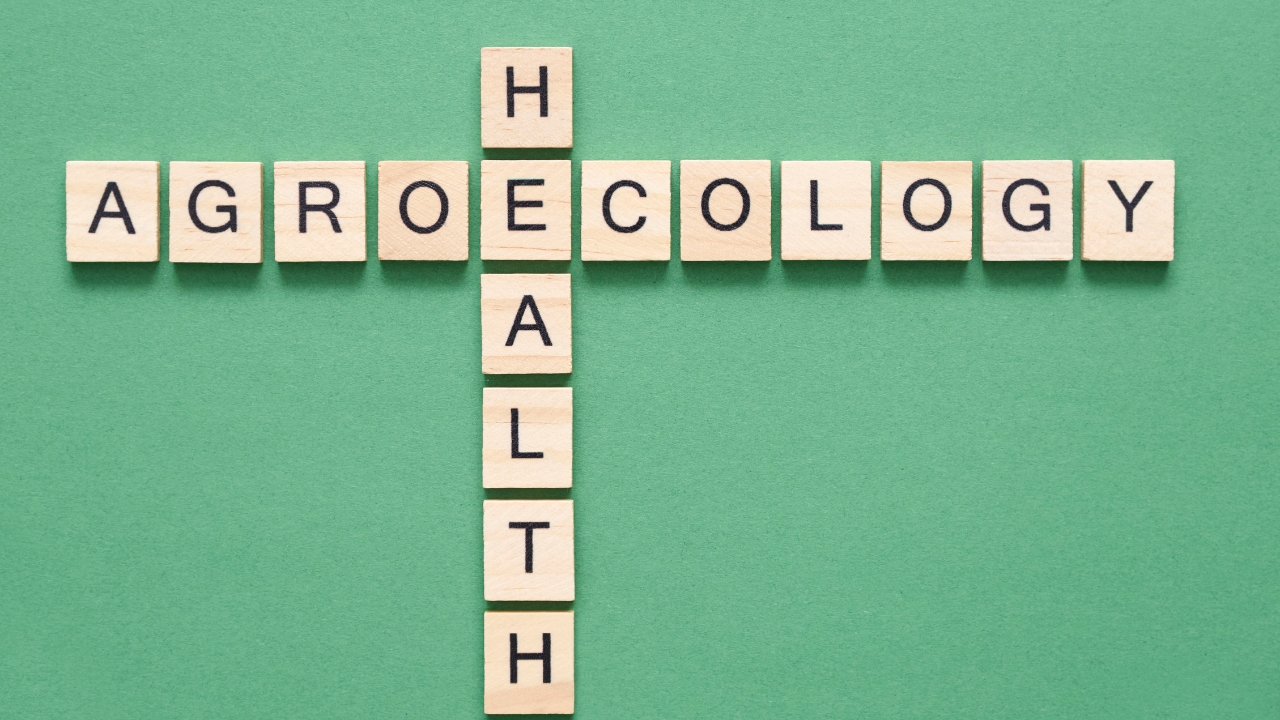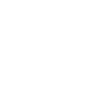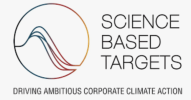Et si restaurer les sols était une condition de survie économique ?
La régénération des écosystèmes agricoles est une nécessité vitale, dans un contexte où les dérèglements climatiques menacent chaque jour davantage la stabilité de nos modèles économiques. Ce qui était hier perçu comme une externalité environnementale devient aujourd’hui un facteur de risque stratégique pour les entreprises. Demain, ce sera tout simplement une condition de résilience.
Dans une économie européenne où les trois quarts des entreprises dépendent directement de la nature dans leur activité, la dégradation continue des écosystèmes (et notamment des sols) représente un coût croissant. Selon la Commission européenne, 60 % des terres agricoles de l’Union sont aujourd’hui dégradées et la perte de services naturels engendrée par cette érosion écologique est déjà estimée à plus de 50 milliards d’euros par an.
Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils se traduisent très concrètement par une instabilité accrue des filières agricoles, une volatilité des prix des matières premières, des tensions géopolitiques liées à l’approvisionnement alimentaire et, pour les entreprises, une remise en cause directe de leur modèle économique.
L’agriculture régénératrice : une solution concrète, aux bénéfices multiples
L’agriculture régénératrice représente bien plus qu’un changement de pratiques. Elle représente un changement de paradigme : plutôt que de dégrader les ressources naturelles en produisant, elle restaure les écosystèmes tout en assurant la pérennité des systèmes agricoles.
En régénérant la vie des sols, en renforçant la biodiversité, en améliorant la gestion de l’eau, elle agit simultanément sur les causes du dérèglement climatique, sur la santé des écosystèmes et sur la rentabilité à long terme des exploitations. Et pourtant, malgré ces bénéfices évidents, sa généralisation reste freinée par un obstacle central : son coût.
La transition régénératrice exige des efforts significatifs de la part des agriculteurs. Changer ses pratiques, revoir son assolement, réduire les intrants, intégrer des couverts végétaux, revoir les itinéraires techniques… tout cela implique du temps, de la prise de risque, et des moyens financiers.
C’est précisément ce que mettent en lumière deux rapports récents :
Le rapport publié par Deloitte et le WBCSD montre qu’au cours des cinq premières années, les agriculteurs doivent assumer un surcoût significatif, lié à la mise en place de nouvelles pratiques. Mais passé ce cap, les bénéfices deviennent clairs : les rendements augmentent, les revenus nets progressent, la rentabilité s’améliore.
Le rapport de l’ECBF rappelle que la transformation de l’agriculture ne pourra se faire à l’échelle qu’à deux conditions : un accompagnement agronomique de long terme et un financement structurant.
Financer la régénération : un investissement collectif
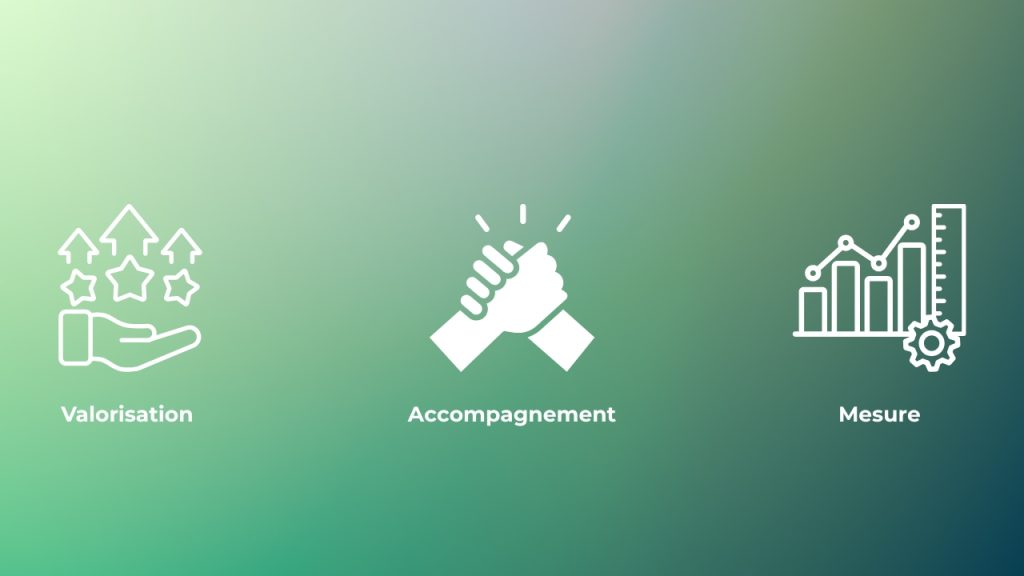
Chez ReGeneration, nous sommes partis de ce constat : on ne transformera pas l’agriculture sans soutien concret, à la fois agronomique et financier. C’est pourquoi nous avons développé un modèle intégral, qui repose sur trois piliers fondamentaux.
Le premier, c’est la valorisation des bénéfices environnementaux. Pour permettre aux agriculteurs d’amorcer leur transition sans mettre en péril leur équilibre économique, nous déployons des dispositifs de valorisation des bénéfices environnementaux à hauteur des besoins réels du terrain.
Le deuxième, c’est l’accompagnement. Car transformer une ferme se construit, pas à pas, au plus près du terrain. Nos agronomes partenaires spécialisés en agroécologie accompagnent les agriculteurs dans la durée, en tenant compte des spécificités de chaque ferme.
Le troisième, c’est la mesure. Toute notre approche repose sur la traçabilité, la transparence et la crédibilité. Grâce à une méthodologie rigoureuse fondée sur les standards internationaux (notamment la méthodologie Verra VM0042), nous mesurons physiquement les effets positifs de la transition : carbone stocké, biodiversité renforcée, qualité de l’eau améliorée. Ces données permettent d’émettre des crédits carbone robustes, traçables, certifiés, intégrant aussi les co-bénéfices environnementaux.
Ce que nous proposons, ce ne sont pas de simples crédits carbone. Ce sont des instruments de contribution climatique construits sur des bases scientifiques, opérationnelles et économiques solides.
Une opportunité stratégique pour les entreprises
Trop souvent, la transition écologique est perçue comme un centre de coûts. Mais dans le cas de l’agriculture régénératrice, c’est exactement l’inverse : c’est un levier de création de valeur.
Investir dans la régénération des écosystèmes, c’est sécuriser à l’avenir l’accès aux ressources naturelles. C’est anticiper les exigences réglementaires à venir. C’est répondre aux attentes des consommateurs en matière de transparence et d’impact. C’est renforcer l’ancrage territorial, et donc la résilience logistique. Et surtout, c’est sortir des logiques spéculatives et du greenwashing, pour inscrire sa stratégie climat dans le réel.
Contribuer à la transition régénératrice via des crédits carbone issus de ces démarches, c’est faire le choix d’une contribution crédible, durable, mesurable et valorisable. Et c’est, aussi, soutenir celles et ceux qui régénèrent les écosystèmes à la racine.
Un levier pour préserver la rentabilité à long terme
L’agriculture régénératrice crée de la valeur dans le temps.
Pour l’agriculteur, cela se traduit par une réduction des charges, une meilleure autonomie, une fertilité naturelle retrouvée.
Pour l’entreprise qui s’y associe, investir dans la régénération des écosystèmes est un moyen de préserver sa compétitivité et sa propre rentabilité à terme, en limitant le renchérissement des ressources naturelles, atténuant le coût des processus supplémentaires liés au changement climatique ou de la répercussion des catastrophes, allégeant les pressions financières et en faisant disparaître les menaces pour leur réputation.
Un écosystème fragilisé menace l’ensemble de l’économie ; investir dans sa transformation maîtrisée, c’est investir dans la résilience de demain, pour tous.
À mesure que les écosystèmes sont restaurés, la rentabilité économique elle-même devient plus résiliente. Parce qu’elle n’est plus fondée sur l’extraction de ressources limitées, mais sur la vitalité d’un système vivant, régénératif, et auto-renforçant.

Reconstruire la valeur, ensemble
La transition agricole ne pourra pas se faire sans les entreprises. Non seulement parce qu’elles y ont un rôle majeur à jouer, mais surtout parce qu’elles ont tout à y gagner.
Le climat, la biodiversité, la fertilité des sols, l’eau : ce sont les infrastructures naturelles de notre économie. Les régénérer, c’est en garantir la pérennité. C’est anticiper les risques.
C’est créer une économie qui respecte les limites planétaires, tout en continuant à produire, à innover, à prospérer.