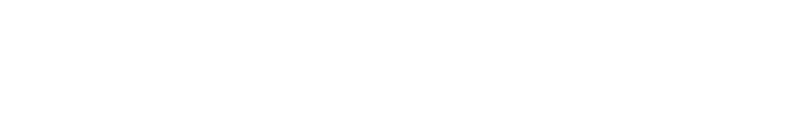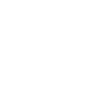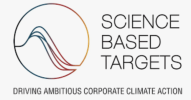L’agriculture ne se limite pas aux cultures et aux sols. Elle est aussi un écosystème où interagissent plantes, insectes, oiseaux et micro-organismes. L’un des piliers de l’agriculture régénératrice repose sur la restauration de ces interactions grâce aux infrastructures agroécologiques : haies, bandes enherbées, mares, couverts végétaux…
Ces aménagements permettent de créer des habitats naturels, d’améliorer la fertilité des sols et de favoriser une production agricole plus résiliente face aux aléas climatiques et aux ravageurs.
Pourquoi restaurer la biodiversité agricole ?
L’intensification de l’agriculture a conduit à une forte diminution des habitats naturels, entraînant un déclin significatif de la biodiversité. La disparition des haies, la suppression des prairies naturelles et l’usage intensif d’intrants chimiques ont affaibli les écosystèmes agricoles, provoquant une réduction des pollinisateurs, une prolifération des ravageurs et une érosion accrue des sols.
Restaurer des infrastructures agroécologiques permet de rétablir ces équilibres naturels en offrant des habitats et des ressources aux espèces bénéfiques. Un sol en bonne santé accueille une biodiversité souterraine riche. Dans un seul centimètre cube de terre, on trouve plus de 10 milliards d’organismes vivants, un chiffre bien supérieur à la population humaine mondiale. Cette activité biologique contribue directement à la fertilité des sols et à leur capacité à stocker du carbone.
Les bénéfices des infrastructures agroécologiques
Favoriser la pollinisation et améliorer les rendements

Les insectes pollinisateurs, tels que les abeilles et les bourdons, sont indispensables à de nombreuses cultures. Pourtant, près de 40 % des populations de pollinisateurs sauvages sont en déclin, principalement en raison de la destruction de leurs habitats et de l’usage intensif de pesticides.
L’absence de pollinisation peut impacter directement les rendements agricoles. Certaines cultures voient leur production diminuer de 20 % lorsque les pollinisateurs viennent à manquer. En intégrant des bandes fleuries et des haies mellifères au sein des exploitations, les agriculteurs peuvent attirer ces insectes et assurer une pollinisation efficace tout au long de l’année.
Lutter naturellement contre les ravageurs

Les monocultures et la disparition des haies ont favorisé la prolifération des ravageurs, augmentant ainsi la dépendance aux pesticides. Sans la présence de prédateurs naturels, certaines cultures peuvent subir des pertes importantes. Une parcelle de céréales, par exemple, peut perdre jusqu’à 30 % de rendement à cause des attaques de pucerons.
L’implantation de haies et de bandes enherbées constitue une réponse efficace à ce problème. Ces aménagements fournissent un habitat aux auxiliaires de cultures, comme les coccinelles, les carabes ou encore les oiseaux insectivores, qui régulent naturellement les populations de nuisibles. Une haie bien implantée peut ainsi réduire de 50 % les attaques de pucerons sur une culture de céréales.
Améliorer la fertilité et la structure des sols
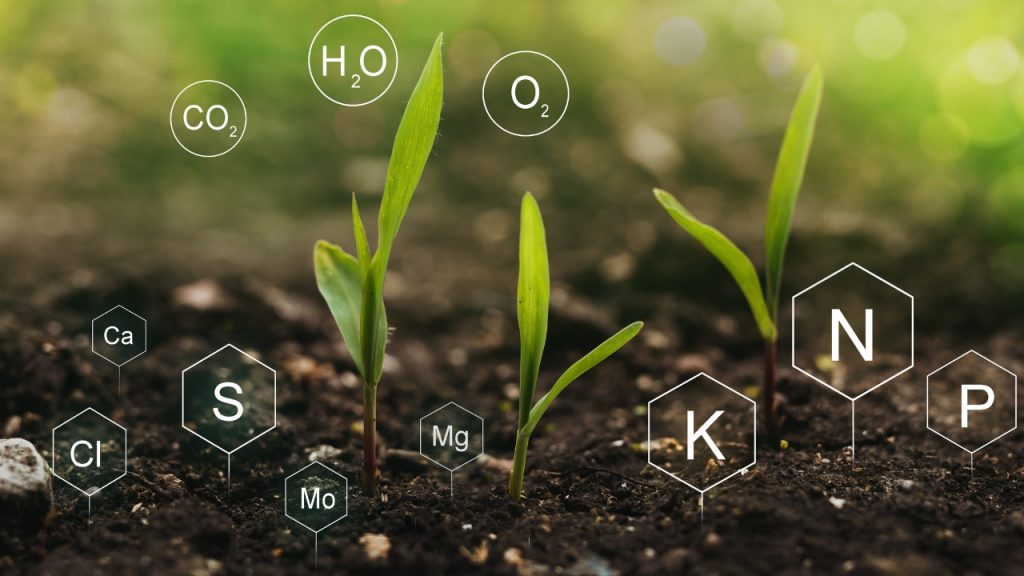
Les infrastructures agroécologiques jouent également un rôle clé dans la préservation des sols. Chaque année, en France, l’érosion entraîne la perte de 30 tonnes de terre par hectare dans les parcelles agricoles exposées. L’absence de végétation sur certaines zones favorise le ruissellement de l’eau, qui emporte avec elle les nutriments essentiels à la croissance des cultures.
Les bandes enherbées et les haies permettent de stabiliser les sols en limitant l’érosion et en favorisant l’infiltration de l’eau. Grâce aux racines profondes des arbres et des plantes vivaces, les sols conservent mieux l’humidité et deviennent plus résistants aux périodes de sécheresse. Une haie bien positionnée peut ainsi permettre de stocker deux à trois fois plus d’eau en cas de fortes précipitations, réduisant le stress hydrique pour les cultures environnantes.
Comment intégrer ces infrastructures dans une exploitation ?
Avant d’installer des infrastructures agroécologiques, il est essentiel d’identifier les besoins spécifiques de l’exploitation. L’observation des parcelles permet de repérer les zones les plus exposées à l’érosion, les secteurs nécessitant une protection contre le vent ou encore les parties de l’exploitation où l’activité biologique du sol est faible.
La diversification des infrastructures est un élément clé de leur efficacité. Les haies champêtres servent de brise-vent et d’abri pour la biodiversité. Les bandes enherbées et fleuries favorisent la pollinisation et la lutte biologique contre les ravageurs. Les mares et zones humides, quant à elles, jouent un rôle essentiel dans la régulation du microclimat et la préservation des ressources en eau. Une ferme combinant ces différents éléments peut réduire de 60 % sa dépendance aux intrants chimiques en restaurant un équilibre écologique fonctionnel.
L’entretien des infrastructures est tout aussi important que leur implantation. Une haie doit être taillée en tenant compte des cycles de reproduction des oiseaux. Les bandes enherbées ne doivent pas être tondues intégralement afin de préserver des refuges pour la faune. Autour des mares, une végétation naturelle doit être maintenue pour limiter l’évaporation et favoriser la biodiversité aquatique.